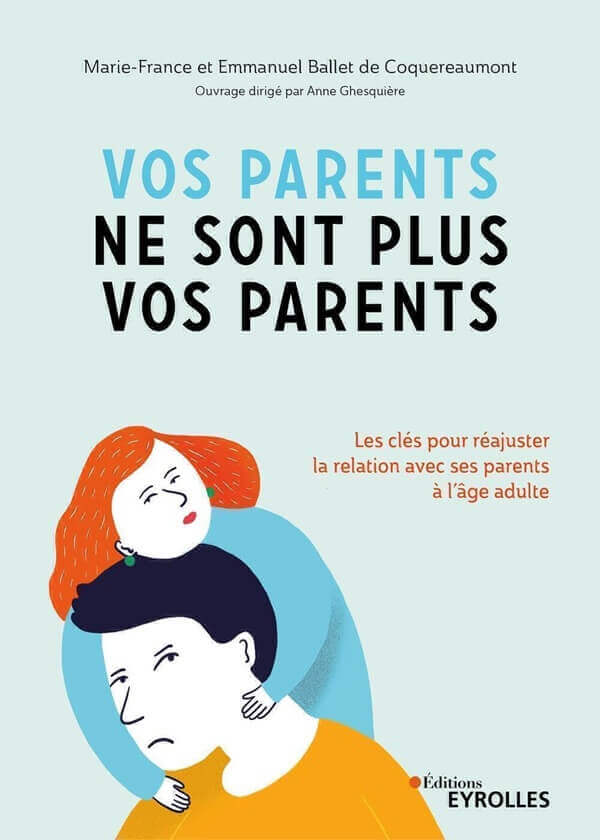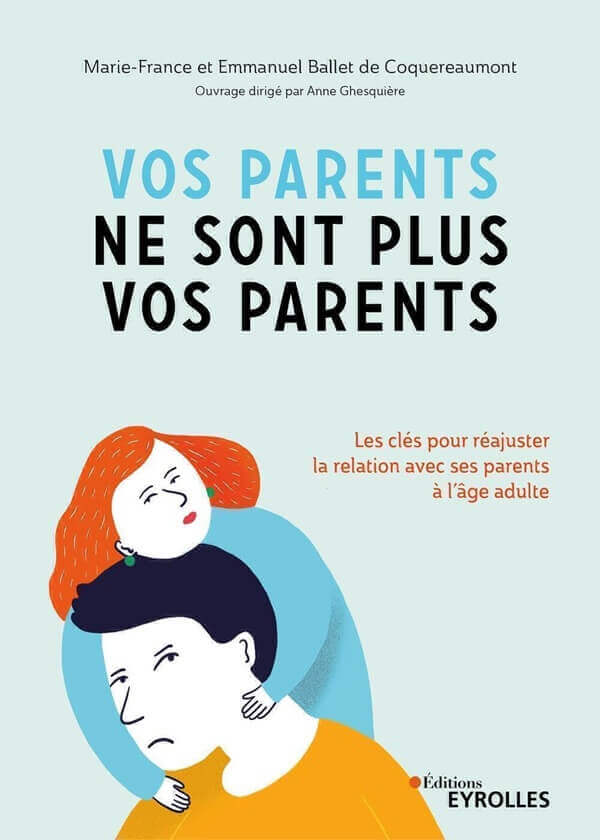
un ouvrage de psychothérapie d’inspiration psychanalytique et humaniste
Le livre Vos parents ne sont plus vos parents : Les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l’âge adulte, écrit par Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont, psychopraticiens d’inspiration jungienne et spécialistes de l’enfant intérieur, propose une révolution dans la perception des relations intergénérationnelles. La thèse fondamentale est que, pour un adulte, l’idée que « Vos parents ne sont plus vos parents » peut être un véritable soulagement. Les auteurs soutiennent que le maintien d’une fonction parentale à l’âge adulte est anachronique et source d’attachements douloureux, voire toxiques. Le défi de l’ouvrage est de fournir les clés pour créer une relation « ex-enfant/ex-parent mature, pacifiée et intègre ». Remettre en cause la fonction parentale une fois l’âge adulte atteint est encore un tabou dans la société. Les auteurs s’appuient sur leur pratique de trente ans en psychothérapie pour partager des analyses et des propositions qui se sont révélées opérantes pour de nombreuses personnes
Première Partie : La déconstruction des représentations obsolètes
La première partie de l’ouvrage invite le lecteur à transgresser l’ordre établi en remettant en cause les croyances qui entravent un sain développement personnel et relationnel. La fonction parentale est définie comme étant à durée déterminée. L’idée que le parent reste à tout jamais parent et que l’enfant reste toujours l’enfant de son parent est dénoncée comme l’un des éléments d’un cadenas relationnel qui empêche toute véritable évolution dans le lien adulte. Ce blocage repose souvent sur l’idéologie selon laquelle tout ce que fait le parent est « C’est pour ton bien ». Le livre critique l’idée que les parents n’ont que de bonnes intentions, soulignant que l’amour ne saurait justifier n’importe quel comportement, en particulier lorsqu’il ordonne à l’ex-enfant un silence respectueux. Une culpabilité toxique s’installe souvent, faisant croire à l’adulte qu’il est prisonnier et que le confort de son parent doit primer sur le sien.
L’ouvrage déconstruit également la confusion des dimensions de la parentalité. La parentalité se compose de trois dimensions : charnelle (filiation), symbolique (fonction parentale : protéger, pourvoir et permettre à l’enfant de devenir qui il est) et relationnelle (la nature du lien). C’est la dimension relationnelle, qui est l’histoire d’une relation complexe, qui prime, et non la filiation ou la fonction, pour comprendre le lien à l’âge adulte. Les auteurs critiquent aussi fortement le mythe de la famille idéale, désigné comme le « syndrome de La Petite Maison dans la prairie », qui est souvent une « usine à fabriquer des gens » selon Virginia Satir. Ce mythe perpétue l’illusion que la famille est exempte de dysfonctionnements et qu’elle est la seule source d’amour véritable. L’idée multiséculaire de la dette éternelle envers les parents est également rejetée, car elle maintient l’ex-enfant dans une position de redevable. Les auteurs insistent sur le fait que l’enfant ne doit rien automatiquement à son ex-parent. Il est essentiel de reconnaître et de nommer la violence subie, y compris la Violence Éducative Ordinaire (VEO), souvent banalisée, pour se libérer de cette dette. Le lien est une passerelle fragile qui peut se défaire, et son réajustement est la responsabilité de chaque adulte.
Deuxième Partie : L’emprise de l’éternel enfant adapté
La deuxième partie analyse les mécanismes psychologiques qui maintiennent l’adulte dans la position d’« éternel enfant face à son parent », état psychique figé dans un passé qui ne passe pas. L’adulte est alors sous l’influence de l’« enfant adapté », une partie de la psyché qui, par des croyances et des comportements rigidifiés, plonge l’adulte dans des « transes infantiles ». Ces transes (temporelles, corporelles, psychologiques, spirituelles) empêchent l’adulte d’évaluer correctement le présent et de prendre des décisions éclairées. L’individu se protège ainsi de la souffrance originelle et du chaos de l’enfance.
L’enfant adapté s’exprime au travers de stratégies de survie et d’autoprotection (soumission, évitement, dépendance, contrôle, pouvoir), qui ont été nécessaires à l’enfant pour survivre mais qui sont devenues un carcan à l’âge adulte.
Deux schémas relationnels principaux maintiennent cette stagnation :
1. L’Adulte Infantilisé : Cet adulte est maintenu dans une dépendance forte (affective, morale, financière, etc.) à son parent, vivant dans une « prison circulaire » où toute sa sève est dédiée à une fonction familiale, l’empêchant de croître pour lui-même. Cette dépendance résulte d’une synergie entre le pouvoir du parent, la dépendance de l’enfant et sa sujétion. Le « phénomène Tanguy », par exemple, est souvent la conséquence d’un dysfonctionnement familial et non d’un simple choix. L’adulte infantilisé peut également développer une pseudo-autonomie en s’isolant et en se montrant contre-dépendant, tout en étant financé ou soutenu par le parent.
2. L’Adulte Parentifié : L’enfant, devenu adulte, est piégé dans une mission impossible de prendre en charge les besoins affectifs ou physiques de son parent. Ce rôle est une inversion des rôles qui exploite les capacités naturellement empathiques de l’enfant par l’emprise affective, souvent encouragée socialement et confondue avec un devoir filial sain. L’adulte parentifié, malgré son apparence de force et de responsabilité, souffre d’une grandiosité qui masque un vide intérieur et le mène à l’épuisement ou au burn-out.
Ces dysfonctionnements sont consolidés par la loyauté invisible, un canal de transmission des attentes parentales qui force l’individu à choisir entre son intégrité et la fidélité au système familial. Résoudre ce conflit de loyauté est essentiel pour s’orienter vers une nouvelle alliance.
Troisième Partie : L’éveil de l’adulte intérieur et la réalliance
La troisième partie présente la construction d’un nouveau paradigme relationnel. Devenir adulte est un processus d’individuation (concept de C. G. Jung), une quête de maturité et d’intégrité qui exige le deuil de la fonction parentale extérieure. La maturité invite l’individu à intégrer les limites et les paradoxes inhérents à la nature humaine. Le deuil d’un parent est un jalon qui force l’adulte à se séparer symboliquement de ses habits filiaux et à devenir son propre parent.
L’étape cruciale est l’autoparentage. L’adulte prend la responsabilité de sa propre guérison en devenant son propre allié et en tissant un nouveau lien avec son enfant intérieur (le Moi véritable, sensible et vulnérable). L’autoparentage n’est pas égoïste, mais favorise une ouverture nouvelle à autrui.
Pour se libérer des liens toxiques et de la mystification parentale, il est impératif de sortir du secret et de nommer les abus et les violences subies. Le travail de guérison implique de restituer symboliquement la violence au parent. Cette restitution est une libération énergétique et psychologique pour l’ex-enfant, et elle permet à l’ex-parent de récupérer la pleine responsabilité de ses actes passés. C’est un processus qui permet de se pacifier et de condamner l’inefficacité des violences subies.
Le réajustement relationnel est une compétence adulte qui s’appuie sur deux principes fondamentaux pour construire une relation saine et respectueuse :
1. Le Principe d’Équité : Recherche de justice et de justesse. Cela implique l’établissement d’une juste distance (physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle) pour éviter la symbiose et permettre la reconnaissance de chacun comme personne différenciée et spécifique.
2. Le Principe d’Équidignité : Ce concept de Jesper Juul reconnaît que tous les individus ont la même valeur intrinsèque, quel que soit leur âge. L’équidignité s’oppose à la hiérarchisation traditionnelle de la relation.
Pour garantir une nouvelle alliance, l’ouvrage propose l’établissement de nouvelles règles relationnelles explicites, dont : le droit à l’erreur (favorisant la résilience et l’apprentissage), le droit d’affirmer son ressenti (et d’être confirmé dans celui-ci), le droit de s’indigner contre la violence, le droit de retrait (se séparer temporairement pour digestion émotionnelle), le droit de démissionner de la fonction parentale ou filiale, et le droit de se réactualiser (se désidentifier des rôles figés du passé). L’objectif est de se libérer des masques pour être soi-même et favoriser la compassion, la responsabilité et la liberté au cœur des liens humains.