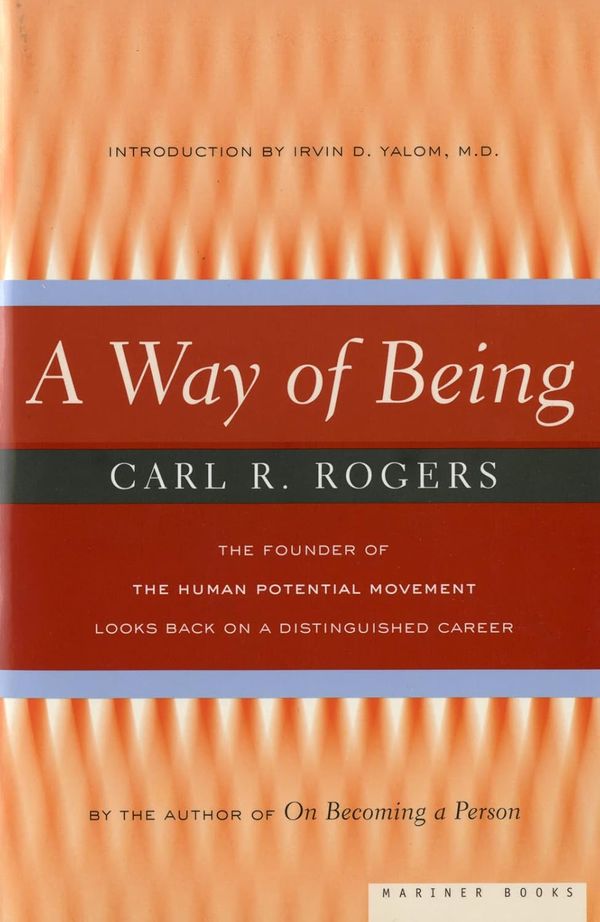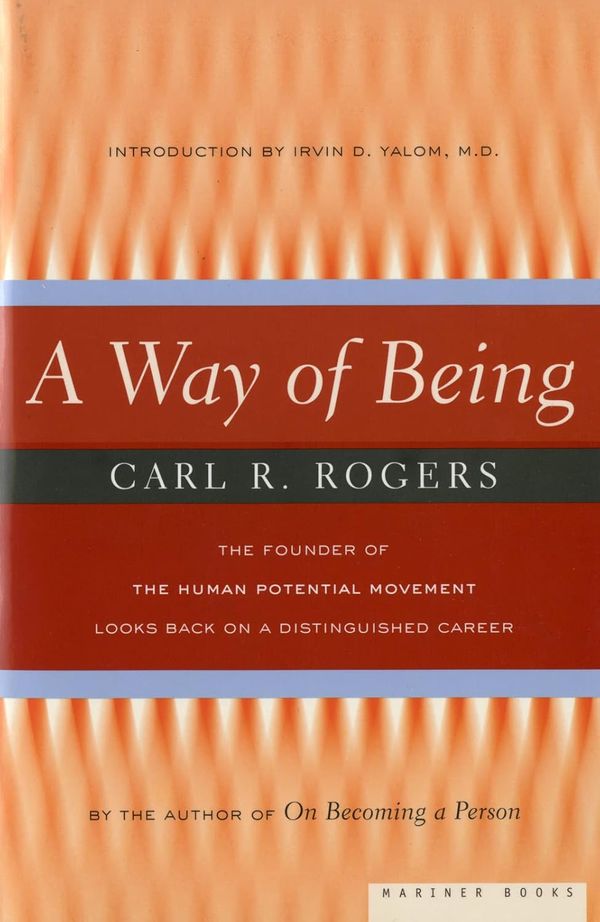
Un texte ancien qui reste inspirant
Publié en 1980, A Way of Being représente le testament intellectuel de Carl Rogers. L’ouvrage rassemble les réflexions d’une vie entière consacrée à comprendre ce qui favorise le développement psychologique de l’être humain. Plus qu’un simple traité de psychologie, il s’agit d’une philosophie de la relation et d’une éthique de la présence. Rogers y expose sa vision de l’homme comme être en devenir, capable de croissance dès lors que le climat relationnel le permet. L’œuvre prolonge les grands textes antérieurs (Counseling and Psychotherapy, 1942 ; On Becoming a Person, 1961), mais elle s’en distingue par un ton plus intime, existentiel et universel.
Du “client-centered therapy” à l’“approche centrée sur la personne”
Au fil de sa carrière, Rogers a vu son approche s’élargir du cadre strict de la psychothérapie à l’ensemble des relations humaines. Il ne parle plus seulement de “client” ni même de “patient”, mais de personne. Ce changement de vocabulaire traduit une révolution conceptuelle : ce qui importe n’est pas la technique, mais la qualité du lien.
L’« approche centrée sur la personne » repose sur trois attitudes fondamentales du thérapeute :
- La congruence — être authentique, c’est-à-dire en accord avec soi-même dans la relation.
- L’acceptation inconditionnelle — accueillir l’autre sans jugement ni condition.
- L’empathie — comprendre le monde intérieur du client comme s’il s’agissait du sien, tout en restant capable de garder une distance réflexive.
Ces trois attitudes constituent, selon Rogers, les conditions nécessaires et suffisantes au changement thérapeutique. Lorsque ces conditions sont réunies, la personne trouve en elle-même les ressources nécessaires pour se développer. Le rôle du thérapeute n’est donc pas de « corriger » ni de « diriger », mais de faciliter la croissance naturelle de l’individu.
Cette perspective s’oppose radicalement à la psychologie behavioriste, qui réduit le comportement à des conditionnements, et au modèle psychanalytique, fondé sur l’interprétation de l’inconscient par un expert. Rogers défend au contraire une vision autodéterminée de l’être humain, animé par une tendance actualisante : une force interne de développement comparable à celle d’une graine qui devient arbre si les conditions du sol sont favorables.
Communication et authenticité : une pratique de la présence
Le premier chapitre, « Experiences in Communication », illustre de manière vivante cette philosophie. Rogers y raconte une conférence donnée à l’Institut de Technologie de Californie, où il décida de ne pas “parler de la communication”, mais de communiquer réellement avec son auditoire.
Il explique que la communication véritable ne réside pas dans la transmission d’informations, mais dans la rencontre authentique entre deux subjectivités.
Être entendu profondément, dit-il, libère la personne et lui permet de se réconcilier avec elle-même. Il rapproche cette expérience d’un “prisonnier dans un donjon” qui, après avoir frappé pendant des années sur les murs, entend enfin une réponse.
Rogers décrit aussi les obstacles à cette communication : la peur, le jugement, le conformisme, ou encore le besoin de contrôle. Il souligne que la compréhension empathique exige un renoncement à la toute-puissance intellectuelle du psychologue.
Écouter vraiment, c’est suspendre ses théories pour accueillir ce que l’autre vit dans l’instant.
Cette exigence de présence s’applique aussi à soi-même. Rogers insiste sur la nécessité d’être congruent : percevoir ce que l’on ressent et oser le communiquer sans masque. L’authenticité du thérapeute devient alors un facteur thérapeutique en soi. Il écrit : « Quand la transparence de l’un rencontre celle de l’autre, une relation de type “Je-Tu”, au sens de Martin Buber, devient possible. »
Une psychologie de la croissance et non de la pathologie
Tout au long de A Way of Being, Rogers affirme que la psychothérapie ne vise pas à “réparer” mais à libérer. Il rejette l’idée d’un modèle médical où le thérapeute serait l’expert et le client le malade. L’expérience clinique lui a montré que les personnes changent de manière durable lorsqu’elles se sentent comprises et acceptées, non lorsqu’elles sont dirigées.
Ce principe s’étend selon lui à d’autres contextes :
- Éducation : il plaide pour une pédagogie qui prenne en compte les émotions et la curiosité naturelle des étudiants. L’école devrait être un lieu d’épanouissement plutôt qu’un système de contrôle.
- Entreprises et institutions : il encourage les organisations à favoriser la participation, la confiance et l’initiative plutôt que la hiérarchie rigide.
- Relations interculturelles et diplomatie : dans ses dernières années, Rogers anime des groupes de dialogue entre cultures et nations, convaincu que la compréhension empathique peut contribuer à la paix.
Ainsi, son approche devient une éthique sociale : la manière dont nous écoutons et considérons autrui détermine non seulement le climat d’une relation, mais la qualité de toute une société.
Une pensée enracinée dans l’expérience
L’originalité de Rogers réside dans la cohérence entre sa méthode scientifique et sa philosophie humaniste.
Contrairement à beaucoup de penseurs spirituels, il ne s’appuie pas sur des intuitions abstraites mais sur des observations empiriques. Ses recherches sur la relation thérapeutique — notamment sur l’empathie, la congruence et l’acceptation inconditionnelle — ont ouvert la voie à la psychologie expérimentale du counseling. Il fut l’un des premiers à enregistrer et analyser des séances de thérapie pour étudier objectivement les conditions du changement.
Cependant, cette rigueur ne l’a jamais conduit à réduire la psychologie à la mesure. Dans les années 1970, Rogers s’éloigne du laboratoire pour explorer la dimension existentielle de la relation. A Way of Being témoigne de cette évolution : l’auteur y parle moins en chercheur qu’en témoin. Ses écrits deviennent réflexifs, presque méditatifs. Il s’interroge sur le vieillissement, la mort, la solitude, la paix. Il y a chez le Rogers de la fin une sagesse tranquille, issue de l’expérience plus que de la théorie.
L’homme de demain
Dans la dernière partie du livre, Rogers propose une réflexion prospective sur l’avenir de la civilisation.
Il redoute que la technocratie et la spécialisation excessive ne déshumanisent la société. Les systèmes éducatifs, politiques et économiques tendent, selon lui, à produire des individus conformes, obéissants, mais déconnectés d’eux-mêmes.
Face à cela, il imagine un « homme de demain » capable de vivre dans un monde complexe sans perdre son authenticité. Cet individu sera autonome, créatif, responsable de ses choix et respectueux de ceux des autres. Pour y parvenir, il faudra des institutions nouvelles, fondées sur la confiance, la coopération et le dialogue.
Cette vision rejoint les grands idéaux humanistes du XXᵉ siècle : la croyance en la perfectibilité de l’homme, la primauté de la conscience sur le conditionnement, et la valeur universelle de la relation intersubjective.
Portée et actualité de l’ouvrage
Plus de quarante ans après sa parution, A Way of Being conserve une étonnante actualité. Dans un monde marqué par la vitesse, la performance et la communication numérique, Rogers rappelle la nécessité du contact réel, du temps accordé à l’écoute, et de la bienveillance mutuelle.
Son œuvre invite à une révolution silencieuse : passer d’une psychologie du contrôle à une psychologie de la confiance.
Pour les psychologues contemporains, ce livre demeure une référence éthique. Il ne se lit pas comme un manuel, mais comme un rappel essentiel : le premier outil du thérapeute, c’est sa propre humanité.
Rogers n’y enseigne pas seulement une méthode, mais une attitude intérieure : croire que chaque personne, si elle se sent comprise et acceptée, tend spontanément vers la santé, la liberté et la responsabilité.