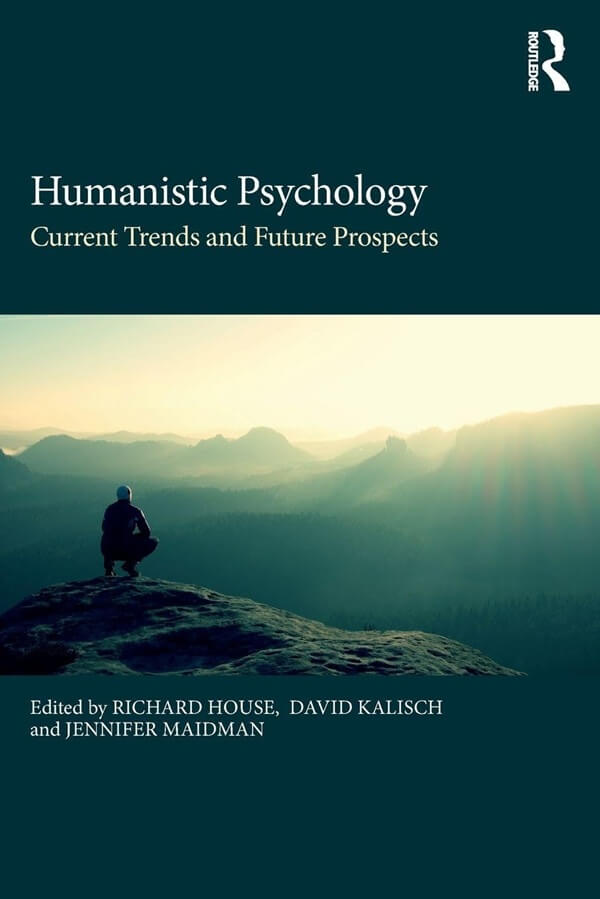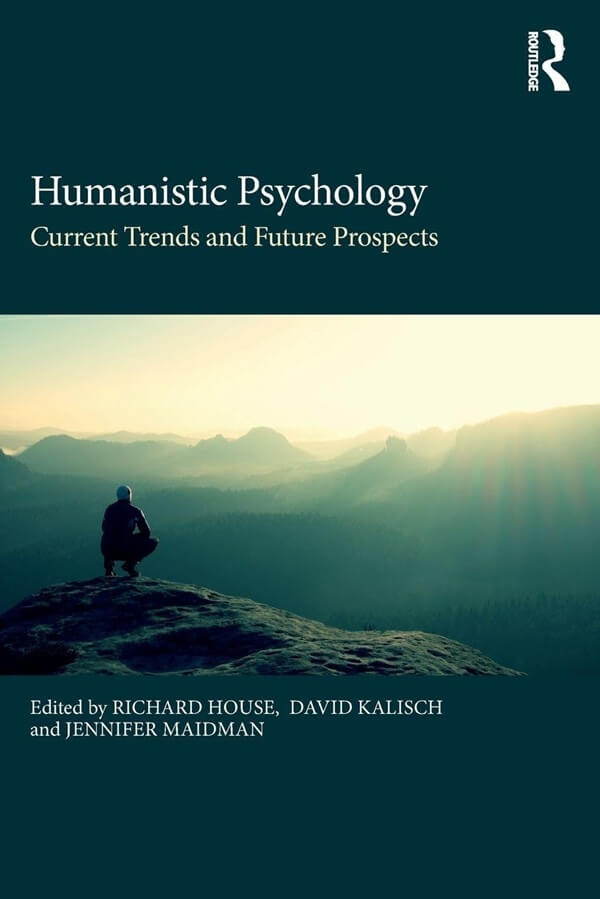
Résumé du livre « Humanistic Psychology: Current Trends and Future Prospects »
Ceci est un résumé des propos du livre de Richard House, David Kalisch et Jennifer Maidman. Le livre Humanistic Psychology: Current Trends and Future Prospects se présente comme un tour d’horizon complet de l’état actuel de la psychologie humaniste. Rédigé par un collectif international d’experts, l’objectif du livre est de démontrer la pertinence continue des valeurs et des pratiques humanistes. Il s’agit d’un argumentaire passionné en faveur d’une vision de l’être humain qui, selon les auteurs, n’a jamais été aussi nécessaire. Pour saisir la portée de cet argument, il est essentiel de revenir aux origines et aux principes fondamentaux de ce courant.
Éditeur : Routledge
Date de publication : 21 août 2017
Langue : Anglais
Nombre de pages de l’édition imprimée : 310 pages
Genèse et Principes Fondamentaux : La « Troisième Force » en Psychologie
Comprendre les racines historiques et les concepts clés de la psychologie humaniste (PH) est indispensable pour saisir sa position actuelle et les débats qui l’animent. Elle a émergé dans le paysage intellectuel du milieu du XXe siècle comme une « Troisième Force », se définissant en réaction aux limites perçues des deux courants dominants de l’époque : le béhaviorisme, jugé trop réductionniste, et la psychanalyse, perçue comme trop pessimiste et déterministe.
La psychologie humaniste est un phénomène culturel ancré dans le contexte socio-historique des années 1960. Son émergence en Amérique du Nord correspondait au Zeitgeist de l’époque, une période d’expansion, de remise en question des autorités et de soif d’authenticité. Son ethos optimiste, centré sur le potentiel humain, la créativité, l’abondance et l’accomplissement de soi plutôt que sur la pathologie, la rendait à la fois « contre-culturelle et excitante ». Pour une génération en quête de sens et de libération des carcans sociaux, la psychologie humaniste offrait un lexique et des pratiques pour une vie plus authentique et épanouie, loin du conformisme des générations précédentes.
L’ouvrage met en lumière plusieurs concepts qui forment le socle de la pensée humaniste :
L’Auto-actualisation et l’Abondance
Au cœur de la psychologie humaniste se trouve le concept d’auto-actualisation, popularisé par Abraham Maslow. Il ne s’agit pas d’un état final à atteindre, mais d’un processus de développement continu tout au long de la vie. La psychologie humaniste opère ici un changement de paradigme fondamental en matière de motivation. Elle contraste la motivation par le manque (deficiency motivation), où l’action vise à combler une absence (de nourriture, de sécurité, de compagnie), avec la motivation par l’abondance (abundance motivation). Cette dernière est mue par la curiosité, le besoin d’expériences variées et le désir de réalisation. Ce renversement se traduit par le passage de la séquence « AVOIR → FAIRE → ÊTRE » (si j’ai assez de biens, je pourrai faire ce que je veux, et alors je serai heureux) à la séquence « ÊTRE → FAIRE → AVOIR » (si je parviens à être qui je suis vraiment, je ferai des choses qui me satisfont, et j’aurai alors tout ce dont j’ai réellement besoin).
Le Soi Réel vs le Faux Soi
Le concept du « soi réel » (real self) est l’un des plus caractéristiques de la psychologie humaniste. Il est mis en opposition au « faux soi » (false self) ou à la « persona ». Le livre souligne la profondeur de cette dichotomie en rappelant qu’elle a été explorée par de nombreux théoriciens, bien au-delà du seul champ humaniste. Le tableau 1.1 de l’ouvrage, intitulé « Intérieur et extérieur », en témoigne, listant des paires conceptuelles comme le Soi et la Persona chez C.G. Jung, le Vrai soi et le Faux soi chez D.W. Winnicott, ou encore le Soi créatif et la Fiction directrice chez A. Adler. Le « faux soi » est une construction, une « personnalité de relations publiques » bâtie pour nous protéger de la douleur et dépendante de l’opinion des autres. L’authenticité, valeur cardinale de la PH, consiste à découvrir et à accepter ce soi réel, souvent enfoui sous des couches de protections et d’images de soi négatives (le sentiment d’être mauvais, inadéquat ou insatiable). Le chemin vers ce soi réel passe donc fréquemment par la confrontation de ces « secrets » douloureux pour atteindre un état d’intégration où le corps et l’esprit ne font qu’un.
L’Approche Holistique et Expérientielle
La psychologie humaniste insiste sur une approche holistique, qui considère l’être humain comme un tout intégrant les dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Elle valorise de manière centrale l’expérience personnelle et vécue. Contrairement aux thérapies verbales et professionnalisées, la PH a promu des méthodes engageant le corps, le mouvement, l’imagination et l’expression non verbale. Cette philosophie a donné naissance à une institution unique : les « growth centres » (centres de croissance). Des lieux comme l’Institut Esalen aux États-Unis ou l’Open Centre en Angleterre ont été conçus comme des espaces démocratiques, ouverts à tous, où chacun pouvait entreprendre un travail d’auto-exploration, sans qu’il soit nécessaire d’être considéré comme « malade » ou « en difficulté ».
L’État des Lieux : Défis, Critiques et Crise d’Identité
L’ouvrage ne se contente pas de célébrer le passé ; il propose une analyse lucide des difficultés que rencontre la psychologie humaniste dans le monde contemporain. Cette section explore les pressions externes, notamment la domination d’approches concurrentes, ainsi que les questionnements internes qui menacent sa cohésion.
La « Bataille pour l’Âme »
Dans son avant-propos, Andrew Samuels décrit une véritable « bataille pour l’âme » qui a éclaté autour de la prise en charge de la détresse émotionnelle. Cette guerre oppose deux visions du monde : d’un côté, un modèle technocratique et médical qui cherche à mesurer et à pathologiser, et de l’autre, une approche humaniste et expérientielle. Cette bataille se joue sur plusieurs fronts interconnectés. Le premier est celui des thérapies, où des approches comme la Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC) sont favorisées par les systèmes de santé publics (tel le NHS britannique) pour leur efficacité supposée, leur rapidité et leur capacité à être mesurées via des essais contrôlés randomisés (ECR). Cette hégémonie marginalise les thérapies humanistes, psychodynamiques et systémiques, dont la complexité est jugée incompatible avec ce type de validation. Un second front, tout aussi crucial, concerne le diagnostic lui-même, cristallisé autour du DSM-V (le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). Le livre souligne les critiques virulentes adressées à ce manuel pour sa tendance à une « pathologisation trop facile d’expériences humaines pourtant ordinaires, bien que difficiles et douloureuses, comme le deuil ». Ainsi, le débat sur les ECR et celui sur le DSM sont les deux facettes d’un même conflit entre une vision instrumentale de la souffrance et une vision humaniste de l’existence.
Critiques et Faiblesses Internes
L’ouvrage identifie également plusieurs faiblesses inhérentes ou historiques de la psychologie humaniste. Dans une démarche analytique rigoureuse, il présente une évaluation équilibrée, reconnaissant d’abord les forces identifiées par Windy Dryden et Nick Totton, telles que l’accent mis sur la croissance, l’autonomisation du client (empowerment) et une posture non-médicalisante. Cependant, le cœur de la critique se porte sur des faiblesses persistantes :
• Une vision « Pollyanna » de la nature humaine : Une tendance à l’optimisme excessif, qui peut parfois conduire à nier la réalité de la pathologie, de l’agressivité ou de la destructivité, considérées comme de simples masques recouvrant un fond authentiquement bon.
• Le risque de l’individualisme et de l’égocentrisme : Le concept d' »auto-actualisation », mal compris, peut dériver vers une forme d’obsession de soi (self-obsession), détachée des responsabilités sociales et relationnelles. La quête de son « vrai soi » peut devenir un prétexte à l’égoïsme.
• Une faiblesse perçue en matière de recherche : Historiquement, la PH a manifesté une certaine méfiance, voire une attitude négative, envers la rationalité, la théorie formalisée et la recherche quantitative, ce qui a nui à sa crédibilité dans le monde académique et institutionnel.
Crise d’Identité et de Professionnalisation
Un dilemme majeur traverse le champ humaniste aujourd’hui : comment s’adapter au monde moderne sans perdre son âme ? En cherchant la respectabilité professionnelle et en adoptant les « tactiques et tropes » des courants dominants (recherche, publications, accréditations), la PH risque de perdre sa « pureté » et son tranchant contre-culturel. Cette quête de reconnaissance peut mener à une enantiodromia (un basculement total vers son opposé) où l’approche serait édulcorée et absorbée par le courant dominant. Cette crise se manifeste par un déclin du nombre d’adhérents aux organisations humanistes historiques et par un questionnement sur ce qui unit encore les diverses approches (Gestalt, Analyse Transactionnelle, approche centrée sur la personne, etc.) sous une même bannière. Pourtant, malgré ces défis, l’ouvrage démontre que la psychologie humaniste continue d’offrir des perspectives uniques et vitales dans de nombreux domaines d’application.
Applications et Explorations Thématiques : La Pertinence de l’Approche Humaniste
Cette section met en lumière la manière dont le livre illustre la pertinence concrète de la psychologie humaniste dans des domaines spécifiques. Ces explorations démontrent qu’elle est une pratique vivante capable d’aborder des problématiques humaines complexes avec une profondeur uniques.
Créativité et Développement Humain
La créativité est présentée comme un thème central et fondateur de la psychologie humaniste. Le livre explore le concept de « créativité quotidienne » (everyday creativity), qui ne se limite pas aux arts traditionnels mais s’applique à la manière dont une personne vit sa vie, résout des problèmes ou s’adapte à de nouvelles situations. Des figures majeures comme Abraham Maslow et Carl Rogers considéraient la créativité comme une caractéristique inhérente à la nature humaine, un potentiel donné à tous à la naissance, mais qui est « le plus souvent perdu, enterré ou inhibé au fur et à mesure que la personne s’enculture ». Bien plus qu’un simple passe-temps, la créativité est liée à la santé et au processus d’auto-actualisation. L’ouvrage cite des recherches fascinantes sur ses bienfaits, mentionnant un « renforcement de la fonction immunitaire » et suggérant même que les personnes créatives « pourraient vivre plus longtemps ».
Trauma et Croissance Post-Traumatique
Les approches humanistes et existentielles sont décrites comme des ressources précieuses mais sous-estimées dans le traitement du trouble de stress post-traumatique (TSPT). L’ouvrage établit un contraste analytique clair : alors que de nombreuses thérapies se concentrent principalement sur la réduction des symptômes, la PH offre une perspective unique en mettant l’accent sur la construction de sens à partir de l’événement traumatique. Elle explore activement le potentiel de « croissance post-traumatique », où le stress et la souffrance peuvent devenir des catalyseurs pour un développement psychologique positif. Pour les survivants de traumatismes interpersonnels (violences, abus), l’importance accordée à la relation thérapeutique (sécurisante, authentique et empathique) est particulièrement cruciale et curative.
Engagement Sociopolitique et Praxis Culturelle
Loin de l’image d’un mouvement purement individualiste, le livre réaffirme l’engagement historique de la psychologie humaniste dans les questions sociales, culturelles et politiques. S’appuyant sur les travaux de Maureen O’Hara, il présente le concept de « praxis culturelle humaniste » comme une réponse nécessaire à une crise existentielle mondiale. Cette praxis vise à faciliter l’émergence d’une nouvelle conscience, mieux adaptée aux défis du XXIe siècle. Elle s’inscrit dans la continuité de la vision de Carl Rogers, qui avait identifié l’émergence des « personnes de demain » (persons of tomorrow) : des individus caractérisés par leur authenticité, leur ouverture à l’expérience, leur scepticisme envers les institutions bureaucratiques et leur engagement pour la justice et l’écologie. Ces applications concrètes démontrent la vitalité de l’approche et mènent naturellement à une réflexion sur l’avenir et la réinvention nécessaire de la psychologie humaniste pour les décennies à venir.
Visions d’Avenir : Réinventer la Psychologie Humaniste pour le XXIe Siècle
Cette dernière partie de l’analyse se penche sur la dimension prospective du livre, où les contributeurs esquissent les chemins possibles pour l’avenir de la psychologie humaniste. Loin de présenter une vision unifiée, cette section reflète un débat dynamique et essentiel : la PH doit-elle s’intégrer pour survivre et rester pertinente, ou sa force réside-t-elle précisément dans sa capacité à rester en marge ?
D’un côté, des voix appellent à une réinvention profonde. Peter Hawkins lance un appel vibrant à une « révolution nécessaire », critiquant les « sept pièges » de la PH, dont l’individualisme, l’anthropocentrisme et une focalisation excessive sur la croissance. Il plaide pour une « septième vague d’humanisme » qui serait fondamentalement éco-centrée, collaborative et axée sur la co-évolution de l’humanité avec son environnement, dépassant ainsi le mythe de l’auto-actualisation individuelle. Dans une veine complémentaire, John Heron propose une « quatrième vague d’humanisme » qui réintègre pleinement la spiritualité au cœur du domaine humain. Il ne s’agit pas de la séparer dans une dimension « transpersonnelle », mais de la reconnaître dans ses aspects intrapersonnel, interpersonnel et transpersonnel comme partie intégrante de l’expérience, pratiquée à travers une « collégialité » ou régénération collaborative de l’être humain.
De l’autre côté du débat se dresse l’argument de la préservation de l’intégrité contre-culturelle. Les éditeurs du livre eux-mêmes mettent en avant cette tension en citant l’analyse de Richard Mowbray. Selon lui, la force de la psychologie humaniste réside précisément dans sa position marginale. Pour conserver sa capacité à stimuler, à défier les conventions et à critiquer le statu quo, la PH doit « rester en marge ». Le risque d’être « absorbée » et « édulcorée » par le courant dominant est perçu comme une menace existentielle. Cultiver son statut de « frange saine » serait donc la condition de sa pertinence et de son potentiel émancipateur. Ces visions, en dialogue et en tension, tracent les lignes de faille d’un champ en pleine introspection, conscient de la nécessité de se réinventer pour répondre à l’urgence des temps présents.